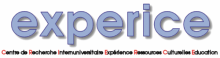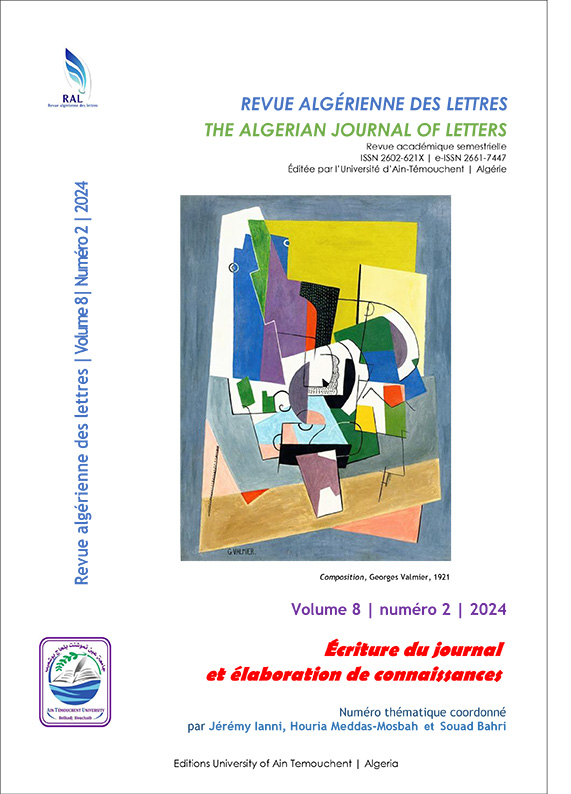N°15 REVUE DE L’AXE A
S’engager pour un agir démocratique entre institutions et territoires
Présentation
La démocratie porte en germe l’idée d’implication de chacun par rapport à des choix collectifs. Si la notion de « démocratie participative » s’est progressivement développée, n’est-ce pas pour la distinguer de la démocratie classique portée par l’élection et les procédures parlementaires ? La démocratie en référence à l’Agora, appelle des discussions et des décisions partagées sans qu’il n’y ait systématiquement recours à des représentants[1] élus. L’intention vise alors à consulter pour ensuite participer à un débat public où puissent explicitement se confronter de multiples points de vue. L’agenda politique est marqué par un souci de démocratie de proximité, comme le stipule la loi du 27 février 2002, dont le double objectif vise à rapprocher fonctionnellement l’administration de l’habitant et à accorder au citoyen un pouvoir de participation directe aux décisions. Dans l’enseignement supérieur, en France et plus particulièrement dans les universités, la participation des personnels ou des usagers est devenue la règle depuis la loi dite Edgar Faure du 12 novembre 1968. Toutefois, si les instances éducatives ne dispensent pas seulement des connaissances, des diplômes et des compétences, comment procèdent-elles pour éduquer, « inculquer des valeurs et des représentations communes, voire des sentiments partagés, au-delà des singularités et des inégalités sociales et culturelles » (Dubet & Duru-Bellat, 2020 : 139) ? Au terme d’une massification scolaire avérée et d’une démocratisation sélective à l’accès à l’enseignement supérieur, qui aurait pu subsumer que ces évolutions conduisent à un affaiblissement du taux de participation, il s’avère selon une récente étude (2023)[2], que les jeunes ne semblent pas avoir démissionné de tout investissement dans la chose publique… Mais, il ne suffit pas de convoquer les citoyens, les représentants d’institutions et les membres de la communauté universitaire à des réunions d’information sur un projet ficelé pour en débattre, il s’agit davantage d’ouvrir un espace d’échanges et de discussions en vue de co-produire et de co-construire. La participation appelle des scènes structurées de délibération, des règles de débat et d’évaluation des effets, et la question de la nature et des contours du débat mérite d’être posée…. Dès lors, il importe d’interroger les modes de faire en matière de gouvernance universitaire et plus particulièrement les dispositifs et modalités de mobilisation et d’association des étudiants au fonctionnement des instances universitaires tant au niveau macro que mezzo et micro. Mais, quel type de participation est proposé aux étudiants au sein des universités, des composantes, des filières d’enseignement ? Dans quelle mesure est-il possible d’évoquer des formes de démocratie participative au sein des universités ? L’engagement dans un cursus universitaire est-il susceptible de contribuer à l’émancipation tant individuelle que collective au sein des instances représentatives des universités et des filières d’enseignement et de formation ? En quoi cet engagement participe-t-il d’un processus d’émancipation et d’acculturation à la vie universitaire, ainsi qu’à la vie dans la cité ? Les universités, invitées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), à construire des dispositifs qui visent à favoriser l’engagement des étudiants et leur participation à la vie des instances de la communauté universitaire sont appelées à imaginer et mettre en place des dispositifs leur permettant d’acquérir des compétences, connaissances et aptitudes dans des cadres autres que ceux des cursus habituels de formation, et à promouvoir et à reconnaître cet engagement… Qu’en est-il aujourd’hui de cette exigence de démocratie et d’implication des « usagers » dans la vie des institutions d’enseignement supérieur et de la cité ? Quels sont les dispositifs mis en œuvre pour répondre aux défis qu’impose cette exigence démocratique ?
Les contributions de Saeed Paivandi et Anaëlle Milon sur les variations de la participation sociale et de l’implication dans la vie collective des étudiants selon des facteurs contextuels et individuels ; de Frédérique Montandon et Zohra Amhed Bacha sur les contours d’un lieu ouvrant un espace de rencontres interculturelles, de participation et de vie citoyenne ; d’Emilie Frenkiel à propos de la convention citoyenne étudiante examinée à l’aune de critères des innovations démocratiques définis par G. Smith (2009) ; de Pascal Lafont et Marcel Pariat étudiant l’intégration ou non des principes de la démocratie participative dans les dispositifs de formation et de Pascal Nicolas-Le Strat et Louis Staritzky mettant en exergue le lien entre l’institution d’enseignement supérieur et la cité à travers l’analyse d’une modalité de coopération entre des étudiants de l’Université Paris 8 et des acteurs de la ville de Saint-Denis, visent à apporter des éléments de réponses à ces interrogations.
[1] Les coordonateurs précisent : ” Bien qu’étant sensibles à la désignation de l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d’assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes, nous éviterons l’usage de l’écriture inclusive, tout au long de ce numéro, afin d’en rendre la lecture plus fluide”.
[2] Étude « Jeune(s) en France » réalisée en octobre 2023 pour The Conversation par le Cabinet George(s) auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes de 18 à 25 ans.
A propos
Numéro Coordonné par Pascal Lafont[1], Frédérique Montandon[2] & Marcel Pariat[3]
[1] Pascal Lafont est maître de conférences HDR en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université Paris Est Créteil – Val de Marne, membre du Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur des pratiques éducatives et des pratiques sociales (LIRTES, EA7313). Président du GIS Redford Institut International. Co-directeur de la revue « Comparaison plurielle : Formation et Développement ».
[2] Frédérique Montandon est maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université UPEC, membre du LIRTES, EA7313).
[3] Marcel Pariat est professeur émérite des universités, HDR en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université Paris Est Créteil – Val de Marne, membre du Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur des pratiques éducatives et des pratiques sociales (LIRTES, EA7313). Président de l’association Redford. Co-directeur de la revue « Comparaison plurielle : Formation et Développement ».
Dernières publications
Revue Sciences du jeu – numéro 23
Revue Sciences du jeunuméro 23 Présentation La musique est une partie importante de nombreux jeux vidéo, et les articles de…
L’éthique au cœur de l’école
L’éthique au cœur de l’école Sommaire du numéro 16 Revue Française d’Ethique Appliquée juin 2025Télécharger Présentation Dans un milieu scolaire…
Revue française d’éthique appliquée – Numéro 16
N°16 Revue française d’éthique appliquée Parler pour les autres ? Sommaire du numéro 16 Revue Française d’Ethique Appliquée juin 2025Télécharger…
PETITE ENFANCE : quelles recherches pour quelles politiques territoriales ?
PETITE ENFANCE : QUELLES RECHERCHES POUR QUELLES POLITIQUES TERRITORIALES ? Pascale GarnierCatherine BouveAna Larrègle Frédérique Le Goffen collaboration avec Laurent Fraisse…
PENSER LE SUJET DANS LA CITÉ
PENSER LE SUJET DANS LA CITÉ Nouveaux défis en Anthropocène Postface de Jean-Philippe PierronChristine Delory-MombergerMartine Janner-Raimondi Préface de Denis Pernot Présentation La création…
Écriture du journal et élaboration de connaissances. Dossier de la revue Revue algérienne des lettres
Écriture du journal et élaboration de connaissances. Dossier de la revue Revue algérienne des lettresCo-coordonné par Houria MEDDAS, Jérémy IANNI…